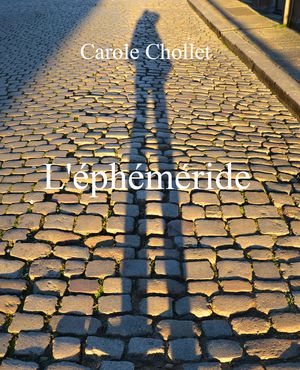La fresque sur le mur s'abîme aux injures de la rue... Pourtant, dans le ciel encore bleu, le papillon vole toujours, léger comme une fleur qu'on aurait jetée aux nuages. Et toujours il échappe au serpent ocellé qui guette avec les lianes.
Les papillons ont-ils des ombres ? Sans doute, puisque chaque tige, puisque chaque fleur, puisque chaque nuage a son ombre. Puisque exister en ce monde, c'est recevoir la lumière.
Le peintre a rêvé ce papillon, il l'a posé tout doucement sur le vieux mur aveugle. Pour le faire exister, petit comme il était, il lui a fait une ombre. Puis il a peint les arbres, les oiseaux, les reptiles, les palmes, le grand ciel, l'œil de bœuf habité d'hirondelles, les grands murs de tuffeau, toutes ces réalisations virtuoses qui font l'admiration des passants.
Sur la pierre de peinture qui grisaille, l'ombre du papillon s'étire infime et ne s'efface pas. Le temps, même, a posé comme un sceau une tache un peu rouge sur son aile si mince.
Là-bas le ciel immense s'écaille et se piquette comme un miroir fané, les grands bouquets d'oiseaux, de reptiles et de palmes pâlissent au temps qui passe et le grand oeil s'éteint. Tandis que, de l'autre côté du vieux tronc qui se penche, les initiales épaisses, rageuses et ennemies, qui montent poing serré à l'assaut de l'insecte déjà se fondent aux pluies.
Et je ne peux m'empêcher de songer que la beauté, même modeste, éphémère, fuyante et frêle, même confiée aux avanies des rues, l'emporte toujours, finalement.
La fresque sur le mur s'abîme aux injures de la rue... Pourtant, dans le ciel encore bleu, le papillon vole toujours, léger comme une fleur qu'on aurait jetée aux nuages. Et toujours il échappe au serpent ocellé qui guette avec les lianes.
Les papillons ont-ils des ombres ? Sans doute, puisque chaque tige, puisque chaque fleur, puisque chaque nuage a son ombre. Puisque exister en ce monde, c'est recevoir la lumière.
Le peintre a rêvé ce papillon, il l'a posé tout doucement sur le vieux mur aveugle. Pour le faire exister, petit comme il était, il lui a fait une ombre. Puis il a peint les arbres, les oiseaux, les reptiles, les palmes, le grand ciel, l'œil de bœuf habité d'hirondelles, les grands murs de tuffeau, toutes ces réalisations virtuoses qui font l'admiration des passants.
Sur la pierre de peinture qui grisaille, l'ombre du papillon s'étire infime et ne s'efface pas. Le temps, même, a posé comme un sceau une tache un peu rouge sur son aile si mince.
Là-bas le ciel immense s'écaille et se piquette comme un miroir fané, les grands bouquets d'oiseaux, de reptiles et de palmes pâlissent au temps qui passe et le grand oeil s'éteint. Tandis que, de l'autre côté du vieux tronc qui se penche, les initiales épaisses, rageuses et ennemies, qui montent poing serré à l'assaut de l'insecte déjà se fondent aux pluies.
Et je ne peux m'empêcher de songer que la beauté, même modeste, éphémère, fuyante et frêle, même confiée aux avanies des rues, l'emporte toujours, finalement.
 On voit encore, dans les villages oubliés, dans les recoins perdus des vieilles villes, des murets de pierres sèches, qu'un artisan d'autrefois a bâtis avec soin, posant les pierres en équilibre, accordant la longue et la brève, la haute et la courte, la creuse et la ronde, comme un poète ses syllabes, comme un musicien ses notes. Et puis aussi de beaux murets de moellons liés à la chaux et au sable, où chaque pierre se cimente doucement aux autres dans son creux de lichen et de mousse.
Mais on ne bâtit plus ainsi. Trop démodé, trop cher, trop long... Même les clôtures de parpaings, encore trop coûteuses à construire, trop lentes à monter, cèdent peu à peu la place à ces murets de grillage, rapidement bâtis, si peu coûteux, qu'on voit partout dans les nouveaux quartiers. On tend sur le sol un filet de fer, puis on y jette, pêle-mêle, des pierres brutes, entassées, prisonnières, ensilées, qui forment de tristes parois de prison au bord de nos chemins. On appelle cela des gabions, paraît-il, d'un mot venu du temps où l'on fabriquait pour la guerre ces remparts de fortune.
Cela fait peine à voir, d'abord, ces gabions. Puis les jours passent, on repasse, peu à peu on voit pointer dans le tas de pierres un brin d'herbe, une fleur, un peu de mousse... on se dit que tout espoir n'est pas perdu, que l'herbe gagnera peut-être, que la mousse s'épaissira, que les angles s'arrondiront, que le temps finira bien par jouer les maçons... pourtant... on reste un peu triste, à regarder ces murs de grisaille et de fer.
C'est que les hommes ressemblent toujours un peu aux pierres dans lesquelles on enferme leurs vies. Dans les vies d'aujourd'hui où l'on bâtit ces murets hâtifs, on entasse les êtres au hasard, pauvres cailloux pris au filet. Pour pas trop cher en vitesse on les pose où on peut comme on peut, bien serrés voilà tout.
Et nul ne se soucie de savoir s'ils sont la pierre longue ou la brève, et nul ne cherche où ils auraient leur place juste.
Et nul ne perd temps ou argent à disposer entre eux et leurs voisins ce lien de bon ciment qui les mettrait en harmonie.
Entassés, ensilés, heurtés, blessés et contraints comme pierres grossières sous le fer du grillage, voilà comment il leur faut vivre. Peut-être finiront-ils par trouver l'herbe et la mousse, la terre qui réunit et la fleur qui éclaire.
Mais, tout de même, qui donc bâtit pour nous ces destins de gabions ?
Et puis, qui donc, jadis, avait écrit ces mots ? - "Je ne bâtis que pierres vives, ce sont hommes."
On voit encore, dans les villages oubliés, dans les recoins perdus des vieilles villes, des murets de pierres sèches, qu'un artisan d'autrefois a bâtis avec soin, posant les pierres en équilibre, accordant la longue et la brève, la haute et la courte, la creuse et la ronde, comme un poète ses syllabes, comme un musicien ses notes. Et puis aussi de beaux murets de moellons liés à la chaux et au sable, où chaque pierre se cimente doucement aux autres dans son creux de lichen et de mousse.
Mais on ne bâtit plus ainsi. Trop démodé, trop cher, trop long... Même les clôtures de parpaings, encore trop coûteuses à construire, trop lentes à monter, cèdent peu à peu la place à ces murets de grillage, rapidement bâtis, si peu coûteux, qu'on voit partout dans les nouveaux quartiers. On tend sur le sol un filet de fer, puis on y jette, pêle-mêle, des pierres brutes, entassées, prisonnières, ensilées, qui forment de tristes parois de prison au bord de nos chemins. On appelle cela des gabions, paraît-il, d'un mot venu du temps où l'on fabriquait pour la guerre ces remparts de fortune.
Cela fait peine à voir, d'abord, ces gabions. Puis les jours passent, on repasse, peu à peu on voit pointer dans le tas de pierres un brin d'herbe, une fleur, un peu de mousse... on se dit que tout espoir n'est pas perdu, que l'herbe gagnera peut-être, que la mousse s'épaissira, que les angles s'arrondiront, que le temps finira bien par jouer les maçons... pourtant... on reste un peu triste, à regarder ces murs de grisaille et de fer.
C'est que les hommes ressemblent toujours un peu aux pierres dans lesquelles on enferme leurs vies. Dans les vies d'aujourd'hui où l'on bâtit ces murets hâtifs, on entasse les êtres au hasard, pauvres cailloux pris au filet. Pour pas trop cher en vitesse on les pose où on peut comme on peut, bien serrés voilà tout.
Et nul ne se soucie de savoir s'ils sont la pierre longue ou la brève, et nul ne cherche où ils auraient leur place juste.
Et nul ne perd temps ou argent à disposer entre eux et leurs voisins ce lien de bon ciment qui les mettrait en harmonie.
Entassés, ensilés, heurtés, blessés et contraints comme pierres grossières sous le fer du grillage, voilà comment il leur faut vivre. Peut-être finiront-ils par trouver l'herbe et la mousse, la terre qui réunit et la fleur qui éclaire.
Mais, tout de même, qui donc bâtit pour nous ces destins de gabions ?
Et puis, qui donc, jadis, avait écrit ces mots ? - "Je ne bâtis que pierres vives, ce sont hommes."
 La caravane était garée dans la cour, l'air de rien... Une vieille caravane, fraîchement repeinte. Et la Joconde à bord...
C'est sûr, si la Joconde vivait aujourd'hui, elle partirait en vacances. En caravane en camping-car en yacht en Ferrari. Elle ferait du tourisme, elle irait à Rome à Paris à Djerba. Elle achèterait des cartes postales et des dépliants en couleurs, on la prendrait en photo. Même elle irait au Louvre pour voir la Joconde, qu'elle observerait comme une autre de très loin dans la foule, derrière les reflets durs de la vitre blindée.
Si la Joconde vivait aujourd'hui, on ferait son portrait en quelques touches abstraites, à l'acrylique ou en sérigraphie, ou même pas du tout, puisqu'on l'aurait tant et tant de fois prise en photo.
Et elle ne sourirait pas à demi, mais tout à fait en grand, pour montrer ses dents blanches, aiguisées à croquer le bonheur et l'argent. Et derrière elle nul ne soupçonnerait cet horizon si vaste, étagé de montagnes, de vallées, de rivières et de ponts, il n'y aurait au fond de son décor qu'une plage au soleil une tour Eiffel une pyramide un atoll un chameau un gratte-ciel...
Plus jamais on ne peindra la Joconde.
Il faut pour faire une oeuvre que se rencontrent un artiste, une époque, un sujet, dans une conjonction idéale aussi extraordinaire que celle qui donne lieu dans l'univers à la naissance d'une étoile.
Jamais ne revient le moment, jamais ne repasse au grand ciel de l'histoire la poussière de comète qui s'est enfuie plus loin.
Si nous l'admirons tant, ce tableau de Léonard, si nous en avons fait l'objet de pèlerinages aussi ardents qu'unanimes, est-ce vraiment parce qu'il surpasse tous les autres ? ou parce que, dans ce portrait plus qu'en aucun autre, nous fascine, dans son mystère fragile, ce moment révélé, cet instant parfait de la Renaissance, unique, à jamais disparu, où l'homme méditant s'est tenu face à la beauté, créateur et maître de toutes choses, au centre d'un monde lumineux dont l'horizon s'élargissait, mordant déjà sur l'ombre, certain encore pourtant de son ordre éternel ? N'est-elle pas, cette Joconde, la quintessence de tout ce que nous avons enfermé, pour oublier que nous l'avions perdu, dans ces musées qui sont nos derniers temples ?
Passants hâtifs égarés dans la foule, voués au commerce, aux crises, aux ruines menaçantes, à l'urgence des mots, aux désirs qui vacillent, nous l'adorons comme une idole, cette Joconde immobile - et il nous faut aussi nous en moquer, comme il nous faut, pressés de ne pas en pleurer, nous moquer de nous-mêmes.
La caravane était garée dans la cour, l'air de rien... Une vieille caravane, fraîchement repeinte. Et la Joconde à bord...
C'est sûr, si la Joconde vivait aujourd'hui, elle partirait en vacances. En caravane en camping-car en yacht en Ferrari. Elle ferait du tourisme, elle irait à Rome à Paris à Djerba. Elle achèterait des cartes postales et des dépliants en couleurs, on la prendrait en photo. Même elle irait au Louvre pour voir la Joconde, qu'elle observerait comme une autre de très loin dans la foule, derrière les reflets durs de la vitre blindée.
Si la Joconde vivait aujourd'hui, on ferait son portrait en quelques touches abstraites, à l'acrylique ou en sérigraphie, ou même pas du tout, puisqu'on l'aurait tant et tant de fois prise en photo.
Et elle ne sourirait pas à demi, mais tout à fait en grand, pour montrer ses dents blanches, aiguisées à croquer le bonheur et l'argent. Et derrière elle nul ne soupçonnerait cet horizon si vaste, étagé de montagnes, de vallées, de rivières et de ponts, il n'y aurait au fond de son décor qu'une plage au soleil une tour Eiffel une pyramide un atoll un chameau un gratte-ciel...
Plus jamais on ne peindra la Joconde.
Il faut pour faire une oeuvre que se rencontrent un artiste, une époque, un sujet, dans une conjonction idéale aussi extraordinaire que celle qui donne lieu dans l'univers à la naissance d'une étoile.
Jamais ne revient le moment, jamais ne repasse au grand ciel de l'histoire la poussière de comète qui s'est enfuie plus loin.
Si nous l'admirons tant, ce tableau de Léonard, si nous en avons fait l'objet de pèlerinages aussi ardents qu'unanimes, est-ce vraiment parce qu'il surpasse tous les autres ? ou parce que, dans ce portrait plus qu'en aucun autre, nous fascine, dans son mystère fragile, ce moment révélé, cet instant parfait de la Renaissance, unique, à jamais disparu, où l'homme méditant s'est tenu face à la beauté, créateur et maître de toutes choses, au centre d'un monde lumineux dont l'horizon s'élargissait, mordant déjà sur l'ombre, certain encore pourtant de son ordre éternel ? N'est-elle pas, cette Joconde, la quintessence de tout ce que nous avons enfermé, pour oublier que nous l'avions perdu, dans ces musées qui sont nos derniers temples ?
Passants hâtifs égarés dans la foule, voués au commerce, aux crises, aux ruines menaçantes, à l'urgence des mots, aux désirs qui vacillent, nous l'adorons comme une idole, cette Joconde immobile - et il nous faut aussi nous en moquer, comme il nous faut, pressés de ne pas en pleurer, nous moquer de nous-mêmes.
J'ai rassemblé dans ce second album une grande partie des textes parus sous ce blog dans la rubrique "Fables" entre janvier 2012 et mars 2013.
Si vous souhaitez les lire, les relire ou simplement les feuilleter, il vous suffit de cliquer sur l'image de couverture, ou sur le lien donné au-dessous :
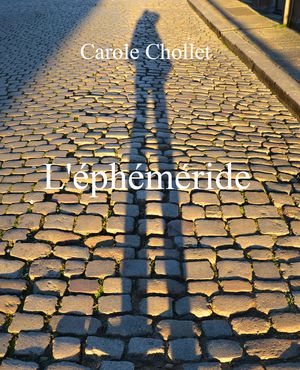 link
Vous pouvez également retrouver ici le lien vers mon album précédent :
link
Vous pouvez également retrouver ici le lien vers mon album précédent :
 link
link
 Un soir avec les autres sur le quai j'étais là j'attendais comme une autre.
J'ai pris cette photo car la ville est ainsi car le monde est ainsi.
Le cliché est un peu de guingois comme moi.
On n'y voit pas grand chose.
Juste que tous ces rêves
ces rêves qu'on nous vend
ne changent pas la vie des passagers du soir attendant sur le quai l'heure de rentrer chez eux.
Ces rêves qu'on nous vend
sont de grands sacs froissés où l'on fourre le butin du Secours populaire du Secours catholique.
Ces rêves qu'on nous vend
sont traînés dans la ville par des passants courbés encombrés de fatigue et de lourde existence.
Ces rêves qu'on nous vend
échouent comme les gens sur les quais sur les bancs dans la pénombre lasse.
J'ai pris cette photo j'avais froid ce soir-là et je ne rêvais pas. J'attendais sur le quai j'attendais sous la pluie j'attendais comme une autre et voilà c'est ainsi.
C'est ainsi qu'est le monde c'est ainsi qu'est la ville c'est ainsi que l'on vit avec ces rêves-là.
Ces rêves qu'on nous vend.
Un soir avec les autres sur le quai j'étais là j'attendais comme une autre.
J'ai pris cette photo car la ville est ainsi car le monde est ainsi.
Le cliché est un peu de guingois comme moi.
On n'y voit pas grand chose.
Juste que tous ces rêves
ces rêves qu'on nous vend
ne changent pas la vie des passagers du soir attendant sur le quai l'heure de rentrer chez eux.
Ces rêves qu'on nous vend
sont de grands sacs froissés où l'on fourre le butin du Secours populaire du Secours catholique.
Ces rêves qu'on nous vend
sont traînés dans la ville par des passants courbés encombrés de fatigue et de lourde existence.
Ces rêves qu'on nous vend
échouent comme les gens sur les quais sur les bancs dans la pénombre lasse.
J'ai pris cette photo j'avais froid ce soir-là et je ne rêvais pas. J'attendais sur le quai j'attendais sous la pluie j'attendais comme une autre et voilà c'est ainsi.
C'est ainsi qu'est le monde c'est ainsi qu'est la ville c'est ainsi que l'on vit avec ces rêves-là.
Ces rêves qu'on nous vend.
 A Blois, je me suis amusée à poser mon image, toute charbonnée de crépuscule, sur un miroir empli de lumière qui s'appelait Jacqueline. Glisser d'un nom à un autre, d'une réalité à son reflet, et d'une vie étroite à la vaste promesse d'une existence neuve... n'est-ce pas mon loisir favori ?
Tout en bas du tableau que composait la vitrine, il y avait un de ces petits cartons jaunes, répandus partout dans la ville en ce début d'année, que Ben a signés, et qui nous demandent d'être curieux en 2013.
Je trouve très étonnant, et finalement remarquable dans sa simplicité, ce travail que fait Ben, qui se contente d'écrire, d'une écriture qui pourrait être la nôtre, des formules très banales, des mots que d'autres disent, mais qui, d'être ainsi calligraphiés, prennent un sens renouvelé.
"Tiens, se dit-on, en effet, si l'on y pense..." Et l'on pense un instant à ce qu'on se contentait de répéter avec les autres, comme si on venait de le coucher sur le papier, de le réinventer d'un geste souple de la main.
Si l'on y pense, si l'on y pense... c'est très curieux, de nous demander d'être curieux en 2013.
D'abord parce que le mot curieux ne peut supporter l'impératif. Jamais la curiosité n'obéira aux ordres de la volonté, puisqu'elle naît justement quand on fait taire la raison, pour plonger à loisir son regard dans la vitrine, de l'autre côté du miroir...
Et puis que veut dire cette date : 2013... ? Pourquoi n'était-on pas curieux en 2012 ? pourquoi ne le serait-on plus en 2014 ? Etre curieux, est-ce une résolution pour l'année nouvelle, qu'on abandonnera comme une mode, pour passer à une autre ? Etre curieux, n'est-ce pas toujours oublier le temps, pour suivre l'élan de l'instant ?
Quand j'étais enfant, on me disait pour me faire taire que la curiosité était un vilain défaut.
C'était aussi absurde d'en faire un défaut, alors, que de vouloir en faire une qualité, aujourd'hui. Aussi absurde que de vouloir faire taire l'enfant né pour parler.
La curiosité n'est ni morale ni immorale, elle n'est rien d'autre que l'envie de traverser le miroir, pour aller plus loin que soi-même, être Jacqueline, discourir avec Ben ou marcher parmi les étoiles. N'a-t-on pas justement appelé Curiosity ce robot que l'un des derniers rêves d'Icare a promené sur Mars, après lui avoir fait traverser l'espace ? La curiosité, c'est cette certitude, émerveillée, gourmande et parfois vorace, mais si simple toujours, que le connu vaut moins que l'inconnu. Juste une forme du désir de vivre.
Un homme sans qualités, on a pu l'imaginer.
Un homme sans curiosité, ne l'imaginez pas. Ce ne serait qu'un mort.
A Blois, je me suis amusée à poser mon image, toute charbonnée de crépuscule, sur un miroir empli de lumière qui s'appelait Jacqueline. Glisser d'un nom à un autre, d'une réalité à son reflet, et d'une vie étroite à la vaste promesse d'une existence neuve... n'est-ce pas mon loisir favori ?
Tout en bas du tableau que composait la vitrine, il y avait un de ces petits cartons jaunes, répandus partout dans la ville en ce début d'année, que Ben a signés, et qui nous demandent d'être curieux en 2013.
Je trouve très étonnant, et finalement remarquable dans sa simplicité, ce travail que fait Ben, qui se contente d'écrire, d'une écriture qui pourrait être la nôtre, des formules très banales, des mots que d'autres disent, mais qui, d'être ainsi calligraphiés, prennent un sens renouvelé.
"Tiens, se dit-on, en effet, si l'on y pense..." Et l'on pense un instant à ce qu'on se contentait de répéter avec les autres, comme si on venait de le coucher sur le papier, de le réinventer d'un geste souple de la main.
Si l'on y pense, si l'on y pense... c'est très curieux, de nous demander d'être curieux en 2013.
D'abord parce que le mot curieux ne peut supporter l'impératif. Jamais la curiosité n'obéira aux ordres de la volonté, puisqu'elle naît justement quand on fait taire la raison, pour plonger à loisir son regard dans la vitrine, de l'autre côté du miroir...
Et puis que veut dire cette date : 2013... ? Pourquoi n'était-on pas curieux en 2012 ? pourquoi ne le serait-on plus en 2014 ? Etre curieux, est-ce une résolution pour l'année nouvelle, qu'on abandonnera comme une mode, pour passer à une autre ? Etre curieux, n'est-ce pas toujours oublier le temps, pour suivre l'élan de l'instant ?
Quand j'étais enfant, on me disait pour me faire taire que la curiosité était un vilain défaut.
C'était aussi absurde d'en faire un défaut, alors, que de vouloir en faire une qualité, aujourd'hui. Aussi absurde que de vouloir faire taire l'enfant né pour parler.
La curiosité n'est ni morale ni immorale, elle n'est rien d'autre que l'envie de traverser le miroir, pour aller plus loin que soi-même, être Jacqueline, discourir avec Ben ou marcher parmi les étoiles. N'a-t-on pas justement appelé Curiosity ce robot que l'un des derniers rêves d'Icare a promené sur Mars, après lui avoir fait traverser l'espace ? La curiosité, c'est cette certitude, émerveillée, gourmande et parfois vorace, mais si simple toujours, que le connu vaut moins que l'inconnu. Juste une forme du désir de vivre.
Un homme sans qualités, on a pu l'imaginer.
Un homme sans curiosité, ne l'imaginez pas. Ce ne serait qu'un mort.
 En te voyant j'ai pensé : "De quelles grilles es-tu vraiment prisonnier ? De ce rideau de fer qui s'est fermé sur toi, ou de ces barreaux d'ombres tatoués sur ton corps et qui revêtent, grise cotte d'illusions, ta nudité fragile ? Tu te tiens droit pourtant, toi qu'on habilla de grillage."
Habitudes, certitudes, névroses et soumissions... Nos chaînes les plus lourdes, nous les portons à même la peau de nos vies. Et les barreaux cerclant de fer nos âmes errantes nous sont aussi nécessaires que les baleines trop serrées de leurs corsets l'étaient à nos aïeules, dont le corps s'écroulait quand on les délaçait.
Nous rêvons d'écarter nos chaînes, de fuir vers l'horizon. Mais saurions-nous aller libres sans tituber, au grand soleil de vérité, au grand vent d'infini ?
En te voyant j'ai pensé : "De quelles grilles es-tu vraiment prisonnier ? De ce rideau de fer qui s'est fermé sur toi, ou de ces barreaux d'ombres tatoués sur ton corps et qui revêtent, grise cotte d'illusions, ta nudité fragile ? Tu te tiens droit pourtant, toi qu'on habilla de grillage."
Habitudes, certitudes, névroses et soumissions... Nos chaînes les plus lourdes, nous les portons à même la peau de nos vies. Et les barreaux cerclant de fer nos âmes errantes nous sont aussi nécessaires que les baleines trop serrées de leurs corsets l'étaient à nos aïeules, dont le corps s'écroulait quand on les délaçait.
Nous rêvons d'écarter nos chaînes, de fuir vers l'horizon. Mais saurions-nous aller libres sans tituber, au grand soleil de vérité, au grand vent d'infini ?
 L'affichette est la dernière, je crois, de toutes celles qu'il y a quelques mois on avait placardées dans la ville, et que j'avais aimées, car elles s'étaient donné mission de nous conduire, en rouges majuscules, aux grands carrefours des mots, et de nous égarer, pour y rêver, sur les chemins toujours nouveaux qu'ils ouvrent à nos pensées anciennes.
Au fil des jours, ces petites affiches, grossièrement imprimées, et collées comme des tracts, au hasard des parois, ont disparu, vaincues par la malveillance et par les pluies d'hiver.
Je ne sais pas ce qui a valu à celle-là d'être ainsi épargnée, mais il me plaît que ce soit elle justement qui survive, prête à résister longtemps encore, épousant le grain du ciment jusqu'à paraître désormais peinte à même le mur, comme les réclames d'autrefois. Car elle contient en ses deux mots ce que disaient ensemble toutes les autres : que peu importe l'oubli ou le mépris, puisque peu importe beaucoup. Que c'est même peut-être ce peu qui importe le plus, et qui emporte avec lui tout le sel et le sens de nos vies provisoires.
Ne dédaignez jamais le peu qui vous est donné, à voir et à aimer. Car ce peu là sera votre tout.
Mais, voyez-vous, peu importe, et même beaucoup !
L'affichette est la dernière, je crois, de toutes celles qu'il y a quelques mois on avait placardées dans la ville, et que j'avais aimées, car elles s'étaient donné mission de nous conduire, en rouges majuscules, aux grands carrefours des mots, et de nous égarer, pour y rêver, sur les chemins toujours nouveaux qu'ils ouvrent à nos pensées anciennes.
Au fil des jours, ces petites affiches, grossièrement imprimées, et collées comme des tracts, au hasard des parois, ont disparu, vaincues par la malveillance et par les pluies d'hiver.
Je ne sais pas ce qui a valu à celle-là d'être ainsi épargnée, mais il me plaît que ce soit elle justement qui survive, prête à résister longtemps encore, épousant le grain du ciment jusqu'à paraître désormais peinte à même le mur, comme les réclames d'autrefois. Car elle contient en ses deux mots ce que disaient ensemble toutes les autres : que peu importe l'oubli ou le mépris, puisque peu importe beaucoup. Que c'est même peut-être ce peu qui importe le plus, et qui emporte avec lui tout le sel et le sens de nos vies provisoires.
Ne dédaignez jamais le peu qui vous est donné, à voir et à aimer. Car ce peu là sera votre tout.
Mais, voyez-vous, peu importe, et même beaucoup !
 Le carreleur des murs est passé partout dans la ville... J'ai retrouvé sa trace encore dans l'une de ces rues pauvres et sales qui bordent l'hôpital. Poète du passage, jardinier de l'infime, il avait déposé sur le ciment rugueux cette fleur battant des ailes, qui ouvrait sur le monde ses longs yeux noirs encore emplis de nuit.
Pariétaire de l'espoir, très haut grimpée dans le gris de ce monde. Petit cosmos un peu penché pour mieux nous regarder. Enfant naïf d'un coeur humain qui croyait sottement que quelques carreaux de couleur pourraient suffire à éclairer les rues et à élever nos regards. Et qui peut-être n'avait pas tort...
Un peu plus loin m'attendait une autre fleur, pâle et mourante, couchée sur le ciment... elle semblait pourtant de son bras tendu m'indiquer le chemin :
Le carreleur des murs est passé partout dans la ville... J'ai retrouvé sa trace encore dans l'une de ces rues pauvres et sales qui bordent l'hôpital. Poète du passage, jardinier de l'infime, il avait déposé sur le ciment rugueux cette fleur battant des ailes, qui ouvrait sur le monde ses longs yeux noirs encore emplis de nuit.
Pariétaire de l'espoir, très haut grimpée dans le gris de ce monde. Petit cosmos un peu penché pour mieux nous regarder. Enfant naïf d'un coeur humain qui croyait sottement que quelques carreaux de couleur pourraient suffire à éclairer les rues et à élever nos regards. Et qui peut-être n'avait pas tort...
Un peu plus loin m'attendait une autre fleur, pâle et mourante, couchée sur le ciment... elle semblait pourtant de son bras tendu m'indiquer le chemin :
 Qui sont-ils donc, ces jardiniers du ciment qui sortent dans la nuit, avec des truelles et des pinceaux, et travaillent sans bruit, grimpés sur des poteaux, accroupis sur le sol, pour qu'au matin s'éveillent, dans le gris de nos vies, ces fleurs fragiles qui peu à peu se flétrissent et s'effacent ?
Qui sont-ils donc, ces jardiniers du ciment qui sortent dans la nuit, avec des truelles et des pinceaux, et travaillent sans bruit, grimpés sur des poteaux, accroupis sur le sol, pour qu'au matin s'éveillent, dans le gris de nos vies, ces fleurs fragiles qui peu à peu se flétrissent et s'effacent ?
 L'engoulant, c'est cette mâchoire de dragon qui orne souvent le coin des poutres maîtresses des plus belles maisons médiévales. C'est cette gueule clouée sur sa morsure qui permet de joindre solidement une poutre horizontale à une poutre verticale, et dont le masque hideux sert de renfort. On n'en a conservé que quelques-uns, de ces engoulants d'autrefois, et j'ai photographié celui-ci à Blois, ville de rois et d'anciennes merveilles.
L'engoulant, c'est, en somme, la part du Mal dans le bel édifice que pensa l'architecte.
Car la Bête, on le sait, partout rôde, et partout menace, et toujours veut détruire ce qui pourrait lui échapper. Aussi - nos ancêtres l'avaient compris -, si l'on veut s'en débarrasser, il faut la laisser entrer au logis, lui faire sa place en la maison, en la logeant en quelque lieu où sa férocité pourra servir. Elle plantera ses dents comme des clous dans la bâtisse, qui n'en sera que plus solide, et, pendant qu'elle sera occupée à mordre goulument les poutres, elle sera bien en peine d'engloutir l'édifice. Et puis, ils avaient, je crois, cette conviction, ces anciens constructeurs, que le temps, la patience, l'ordre harmonieux des jours, à la grâce de Dieu, viendraient à bout de tant de hideur, et que les crocs émoussés de la Bête se confondraient si bien avec la vieille poutre, plus tard, qu'on n'en devinerait plus le dessin féroce qu'à grand effort, et qu'ils finiraient même, peut-être, par devenir tout à fait acceptables.
Ceux qui ont inventé l'engoulant avaient une confiance infinie dans le pouvoir du Bien et du Beau à tout réunir en eux, au bout du compte et du décompte, dans la grande maison du monde.
Mais nous sommes d'un siècle où tant d'édifices se sont effondrés, que nous avons laissé fuir l'engoulant, et voilà que, délivré de sa poutre, il va libre et hurlant, à la haine à la mort, dans les ruines fumantes de nos illusions écroulées.
L'engoulant, c'est cette mâchoire de dragon qui orne souvent le coin des poutres maîtresses des plus belles maisons médiévales. C'est cette gueule clouée sur sa morsure qui permet de joindre solidement une poutre horizontale à une poutre verticale, et dont le masque hideux sert de renfort. On n'en a conservé que quelques-uns, de ces engoulants d'autrefois, et j'ai photographié celui-ci à Blois, ville de rois et d'anciennes merveilles.
L'engoulant, c'est, en somme, la part du Mal dans le bel édifice que pensa l'architecte.
Car la Bête, on le sait, partout rôde, et partout menace, et toujours veut détruire ce qui pourrait lui échapper. Aussi - nos ancêtres l'avaient compris -, si l'on veut s'en débarrasser, il faut la laisser entrer au logis, lui faire sa place en la maison, en la logeant en quelque lieu où sa férocité pourra servir. Elle plantera ses dents comme des clous dans la bâtisse, qui n'en sera que plus solide, et, pendant qu'elle sera occupée à mordre goulument les poutres, elle sera bien en peine d'engloutir l'édifice. Et puis, ils avaient, je crois, cette conviction, ces anciens constructeurs, que le temps, la patience, l'ordre harmonieux des jours, à la grâce de Dieu, viendraient à bout de tant de hideur, et que les crocs émoussés de la Bête se confondraient si bien avec la vieille poutre, plus tard, qu'on n'en devinerait plus le dessin féroce qu'à grand effort, et qu'ils finiraient même, peut-être, par devenir tout à fait acceptables.
Ceux qui ont inventé l'engoulant avaient une confiance infinie dans le pouvoir du Bien et du Beau à tout réunir en eux, au bout du compte et du décompte, dans la grande maison du monde.
Mais nous sommes d'un siècle où tant d'édifices se sont effondrés, que nous avons laissé fuir l'engoulant, et voilà que, délivré de sa poutre, il va libre et hurlant, à la haine à la mort, dans les ruines fumantes de nos illusions écroulées.
 La fresque sur le mur s'abîme aux injures de la rue... Pourtant, dans le ciel encore bleu, le papillon vole toujours, léger comme une fleur qu'on aurait jetée aux nuages. Et toujours il échappe au serpent ocellé qui guette avec les lianes.
Les papillons ont-ils des ombres ? Sans doute, puisque chaque tige, puisque chaque fleur, puisque chaque nuage a son ombre. Puisque exister en ce monde, c'est recevoir la lumière.
Le peintre a rêvé ce papillon, il l'a posé tout doucement sur le vieux mur aveugle. Pour le faire exister, petit comme il était, il lui a fait une ombre. Puis il a peint les arbres, les oiseaux, les reptiles, les palmes, le grand ciel, l'œil de bœuf habité d'hirondelles, les grands murs de tuffeau, toutes ces réalisations virtuoses qui font l'admiration des passants.
Sur la pierre de peinture qui grisaille, l'ombre du papillon s'étire infime et ne s'efface pas. Le temps, même, a posé comme un sceau une tache un peu rouge sur son aile si mince.
Là-bas le ciel immense s'écaille et se piquette comme un miroir fané, les grands bouquets d'oiseaux, de reptiles et de palmes pâlissent au temps qui passe et le grand oeil s'éteint. Tandis que, de l'autre côté du vieux tronc qui se penche, les initiales épaisses, rageuses et ennemies, qui montent poing serré à l'assaut de l'insecte déjà se fondent aux pluies.
Et je ne peux m'empêcher de songer que la beauté, même modeste, éphémère, fuyante et frêle, même confiée aux avanies des rues, l'emporte toujours, finalement.
La fresque sur le mur s'abîme aux injures de la rue... Pourtant, dans le ciel encore bleu, le papillon vole toujours, léger comme une fleur qu'on aurait jetée aux nuages. Et toujours il échappe au serpent ocellé qui guette avec les lianes.
Les papillons ont-ils des ombres ? Sans doute, puisque chaque tige, puisque chaque fleur, puisque chaque nuage a son ombre. Puisque exister en ce monde, c'est recevoir la lumière.
Le peintre a rêvé ce papillon, il l'a posé tout doucement sur le vieux mur aveugle. Pour le faire exister, petit comme il était, il lui a fait une ombre. Puis il a peint les arbres, les oiseaux, les reptiles, les palmes, le grand ciel, l'œil de bœuf habité d'hirondelles, les grands murs de tuffeau, toutes ces réalisations virtuoses qui font l'admiration des passants.
Sur la pierre de peinture qui grisaille, l'ombre du papillon s'étire infime et ne s'efface pas. Le temps, même, a posé comme un sceau une tache un peu rouge sur son aile si mince.
Là-bas le ciel immense s'écaille et se piquette comme un miroir fané, les grands bouquets d'oiseaux, de reptiles et de palmes pâlissent au temps qui passe et le grand oeil s'éteint. Tandis que, de l'autre côté du vieux tronc qui se penche, les initiales épaisses, rageuses et ennemies, qui montent poing serré à l'assaut de l'insecte déjà se fondent aux pluies.
Et je ne peux m'empêcher de songer que la beauté, même modeste, éphémère, fuyante et frêle, même confiée aux avanies des rues, l'emporte toujours, finalement.